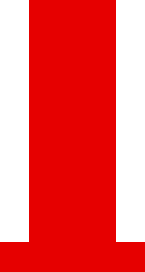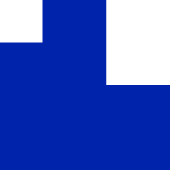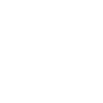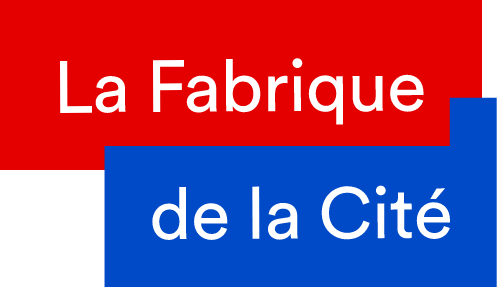« L’archéologie sonore est une manière de patrimonialiser et garder en mémoire la sensorialité du geste » Mylène Pardoën
Dans le cadre du travail sur le bruit en ville, autour de la note De la pollution au paysage sonore. Comment les villes agissent-elles sur l’acoustique urbaine ?, la Fabrique de la Cité a rencontré Mylène Pardoën, spécialiste de l’archéologie du paysage sonore.

La Fabrique de la Cité : Vous avez été pionnière sur ce sujet d’archéologie du paysage sonore. Comment êtes-vous arrivée à travailler sur ce sujet ?
Mylène Pardoën : J’ai commencé ma carrière dans l’armée, puis j’ai fait valider mes années d’expérience pour intégrer une formation universitaire. Après mon master, j’ai conduit une thèse en musicologie, sur la musique militaire.
Puis, la question de la reconstitution sonore s’est imposée : pourquoi ne pas proposer de dispositifs auditifs dans les musées ? J’étais spécialisée dans les sons militaires, et Louis Dandrel, concepteur sonore, mandaté par le musée des Invalides, m’a sollicitée pour sonoriser des plans de bataille avec rigueur scientifique, afin que l’exposition s’appuie sur des reconstitutions sonores historiquement valides. C’est là qu’est née l’idée d’une archéologie du paysage sonore.
Mon travail a ensuite évolué vers les sons liés au patrimoine. J’ai notamment eu pour mission d’enregistrer la signature sonore des gestes des artisans pour le chantier CNRS/MC/Notre-Dame – ce qui était une démarche nouvelle. Nous avons enregistré ces gestes, en nous demandant quels bruits et gestes avaient existé au cours de l’histoire.
Si le bruit est souvent perçu négativement, pour nous, il est essentiellement informatif, il nous donne des indices pour reproduire les ambiances du passé.
LFDC : En quoi consiste l’archéologie du paysage sonore ? Quels sont les indices qui vous permettent de reconstituer des ambiances sonores ?
M.P. : L’archéologie sonore est une science permettant la reconstruction d’un environnement sonore dans un espace spatio-temporel donné. Une méthodologie scientifique, permet de reconstituer les ambiances sonores du passé à partir d’hypothèses historiques plausibles.
Au démarrage, je réalise des recherches dans les archives pour trouver des informations sur les ambiances sonores. Tous types de documents sont bons à prendre pour identifier les sons présents dans un lieu : des sculptures, des textes commerciaux, des indices sur les métiers pratiqués.
Selon l’époque que l’on étudie, on ne dispose pas des mêmes données. Quand on travaille sur le IIIe siècle après Jésus Christ avec des archéologues, on formule des hypothèses à partir de traces graphiques et de textes, mais si l’on étudie la Préhistoire, ça se complique – on trouve beaucoup moins d’informations qu’à des périodes postérieures. Rien ne ressemble plus à une petite murette qu’une petite murette, interpréter et formuler des hypothèses peut devenir très complexe.
Les archives administratives sont très riches et on est assurés que ce qui est écrit dedans est vrai : les testaments nous indique quels objets du quotidien on trouvait dans un foyer, et ainsi quels sons on pouvait y entendre.
Tous les objets ont une signature sonore, comme une montre, le son d’une plume sur un parchemin, un tapis. Leur processus de production également : les tailleurs de pierre, les forgerons, les teinturières ou les vanneuses ont des méthodes de travail qui portent une signature sonore spécifique. Les sources littéraires ou la presse, peuvent également être utiles, mais il faut être prudent sur le contenu et ne pas prendre pour argent comptant ce qu’on peut y lire, qui peut être empreint de subjectivité.
Il faut ensuite se poser la question de l’évolution technique d’un objet et trouver toutes les informations sonores possibles sur celui-ci. À titre d’exemple, une forge n’a pas toujours eu le même son dans l’histoire de son évolution.
LFDC : Quelles sont les étapes pour créer une reconstitution à partir des archives ?
M.P. : Après les recherches en archives, je travaille sur la captation de sons qui me serviront à composer la reconstitution finale. Quand il s’agit de gestes artisanaux, je réalise des prises de son respectant le savoir-faire, en captant le son de la manière la plus complète possible. C’est une manière de patrimonialiser et garder en mémoire la sensorialité du geste. Chaque captation est unique, puisque c’est une possibilité parmi des milliers possibles. Mais ces enregistrements permettent de garder une trace et de participer à maintenir la chaîne de transmission, pour éviter que le geste artisanal, une partie du savoir-faire français, ne se perde. Cette partie du travail est une étape majeure : pour proposer 3 minutes de reconstitution, il faut compter 600 à 700 fichiers.
Une fois les extraits nécessaires collectés, je travaille sur la bande son finale. Je travaille dans une salle d’immersion sonore, à Lyon, qui permet de placer précisément dans l’espace une source sonore en utilisant une série de haut-parleurs et donc de travailler la diffusion sonore en trois dimensions. Cette méthode permet de recréer la densité sonore recherchée.
LFDC : Vous travaillez également à partir de pistes que vous avez enregistrées sur des chantiers ?
M.P. : Je me déplace régulièrement sur des chantiers qui emploient des méthodes historiques, notamment dans la construction, pour enregistrer des sons qui se rapprochent le plus possible de ceux qu’on pouvait entendre à certaines époques. Par exemple au château de Guédelon – un chantier de construction expérimental d’un château fort, où sont employées les techniques et matériaux utilisés au Moyen-Âge. L’artisanat en France est un patrimoine et la restauration de monuments historiques doit être faite avec ces techniques ancestrales.
Malheureusement, ces méthodes artisanales et les paysages sonores qu’elles créent ne font pas encore l’objet d’un classement au patrimoine immatériel de l’Unesco, ce que je souhaiterais. Mais c’est une démarche qui prend du temps, dont je ne dispose pas forcément…
LFDC : Cette méthode a été mise à l’épreuve pour le projet Bretez, de reconstitution des ambiances sonores du Grand Châtelet au XVIIe siècle…
M.P. : Le projet Bretez tire son nom du plan de Paris dessiné par Louis Bretez en 1739. Il s’agissait de reconstituer les ambiances sonores du Grand Châtelet à Paris, avec le Pont au Change et la Conciergerie, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. C’était en 2013, et à ce moment-là le travail historique du paysage sonore n’intéressait pas grand monde. J’ai cherché un lieu dans Paris qui avait des caractéristiques communes à une grande majorité des villes, notamment par sa minéralité.
J’ai travaillé quartier par quartier, pour me faire la main progressivement. La topographie des lieux – qui a changé depuis le XVIIIe siècle, les activités commerciales, les métiers à tisser, les maisons construites au sein même du Pont au Change sont autant de facteurs que j’ai dû prendre en compte pour reconstituer ce paysage sonore. C’est ce projet-là qui a lancé mon travail sur l’archéologie du paysage sonore, et qui m’a permis dernièrement de travailler sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris.
LFDC : Vous avez co-dirigé le Groupe d’études « Acoustique » avec Brian Katz sur le chantier de Notre-Dame-de-Paris. Est-ce que vous observez un intérêt croissant pour l’archéologie du paysage sonore ?
M.P. : Sur le chantier de Notre-Dame, nous avons travaillé sur trois volets :
- les captations sonores avant, pendant et à la fin des travaux, ensuite
- la restitution des ambiances sonores historiques, pour le grand public et à visée scientifique, et enfin
- la patrimonialisation des gestes de l’artisanat, pour conserver le patrimoine immatériel. Ces travaux ont notamment donné lieu à la réalisation d’un modèle numérique de l’acoustique de la cathédrale avant l’incendie de 2019, mais aussi à un film documentaire, intitulé « L’ArchéoConcert : le passé a des oreilles à Notre-Dame-de-Paris1 ».

On observe effectivement un intérêt croissant pour la reconstitution d’ambiances sonores, mais le pas vers l’action et le financement de tels projets est encore rarement franchi. Pour les 4 minutes de reconstitution pour Notre-Dame, il a fallu 500 heures de recherche, 22 jours de captation, 600 heures de création. Nous avons reçu un financement du CNRS et cela a permis de faire travailler plusieurs équipes ensemble.
Les reconstitutions sonores intéressent toujours beaucoup les musées. Pour le musée Carnavalet à Paris, j’ai travaillé à une sonorisation sur la fontaine des Innocents. Le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal m’a demandé de travailler à une recontextualisation des vestiges. Néanmoins, nous n’avons pas toujours la même temporalité : le rythme de la recherche et celui des musées ne sont pas les mêmes et nous avons souvent besoin de beaucoup plus de temps que celui accordé pour répondre aux commandes…
LFDC : Est-ce que le cinéma ou l’industrie du jeu vidéo vous sollicitent pour des reconstitutions sonores ? Cela pourrait les intéresser…
M.P. : Pas vraiment, on relève pour l’instant peu d’intérêt pour ce travail dans le cinéma et les jeux vidéo qui conçoivent, dans leurs productions, des ambiances sonores souvent anachroniques d’un point de vue historique… Ces secteurs semblent en effet plus en recherche du vraisemblable que du réaliste. Par exemple, le son d’une forge tel qu’on se le représente collectivement aujourd’hui est le son d’une forge du XIXe siècle. Une forge médiévale ne fait absolument pas le même bruit, mais c’est le son de la forge XIXe qui sera utilisée, quelle que soit l’époque décrite. Ce sont des représentations collectives, qui sont très difficiles à modifier, quand bien même elles se cristallisent autour de fausses conceptions.

[1] https://www.cnrs.fr/fr/presse/avant-premiere-de-larcheoconcert-le-passe-des-oreilles-notre-dame-de-paris
Interview réalisée par Marianne Laloy Borgna, chargée d’études de La Fabrique de La Cité.
Retrouvez cette publication dans le projet :
Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.