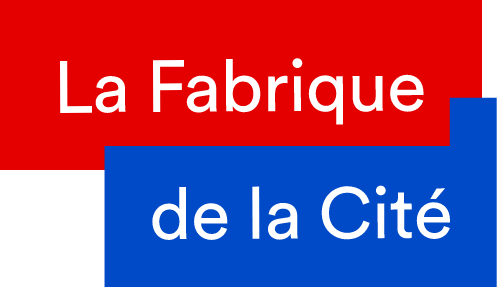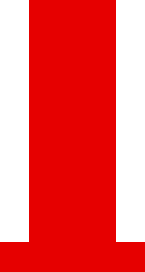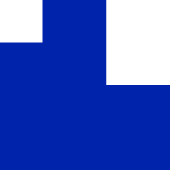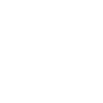Vidéo



Réindustrialisation
Dernières publications
-
Colloque du 14 mai « Le renouveau industriel bas carbone des territoires : à quelles conditions ? »
-
La réindustrialisation au défi du zéro artificialisation nette des solsPoint de vue d'expert
-
Villes moyennes, villes en mouvement
-
Retour de Roanne et Montbrison : la quatrième édition des Rencontres des villes moyennes en vidéo