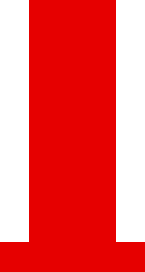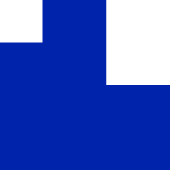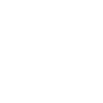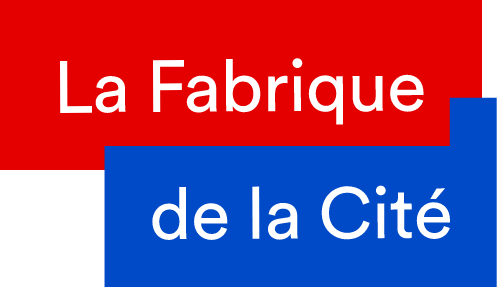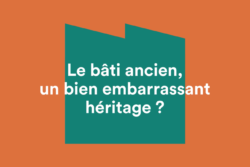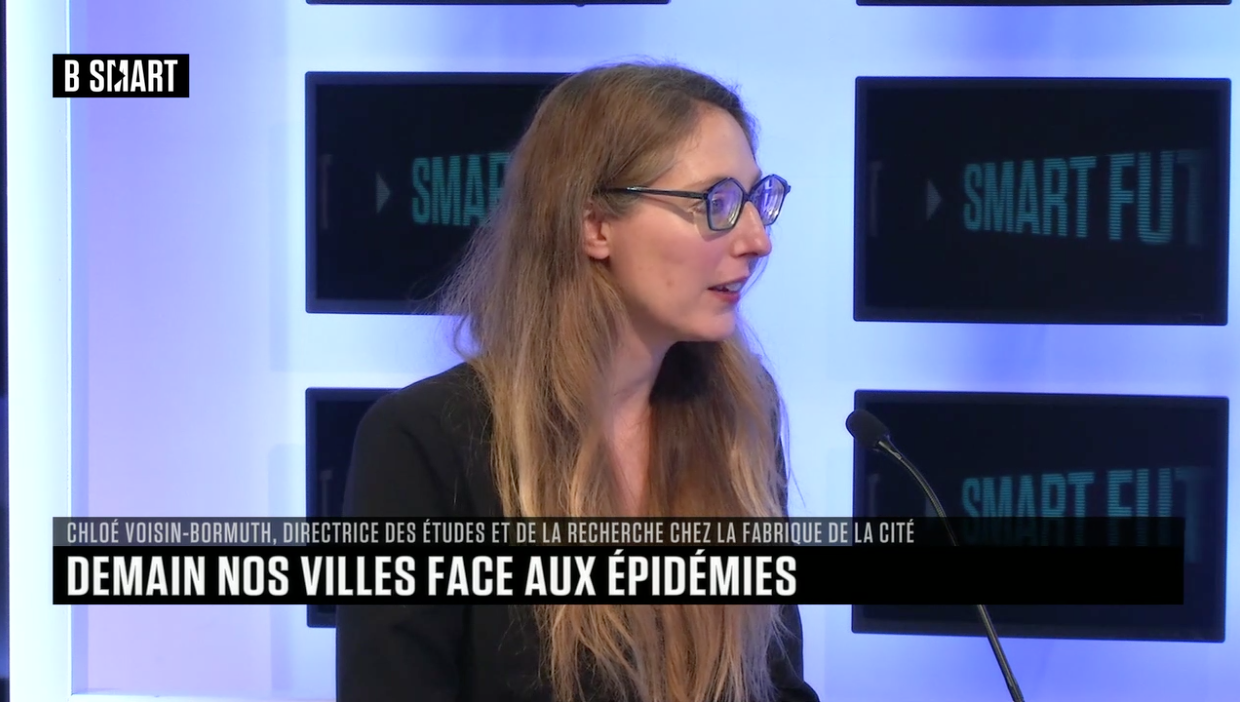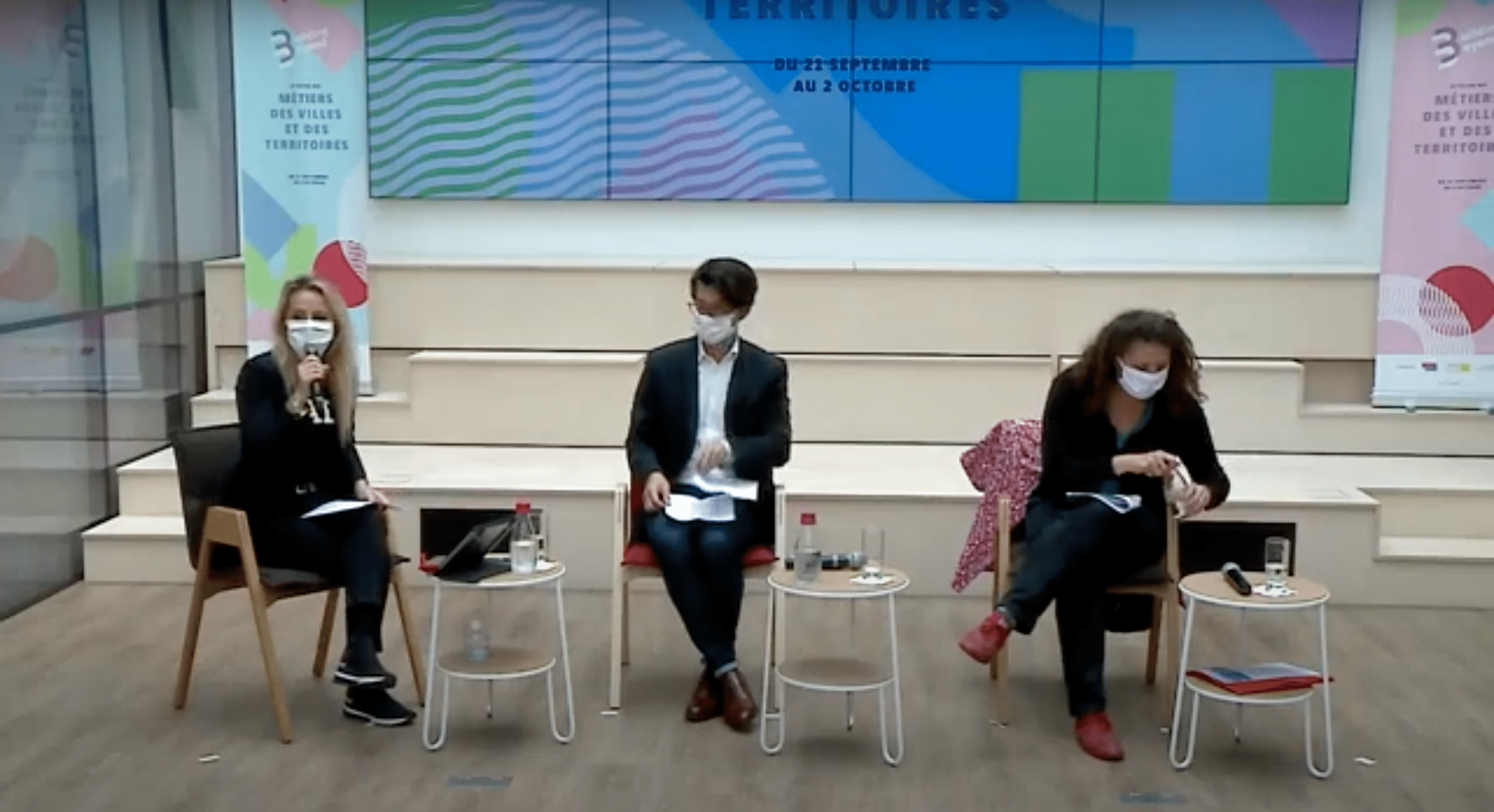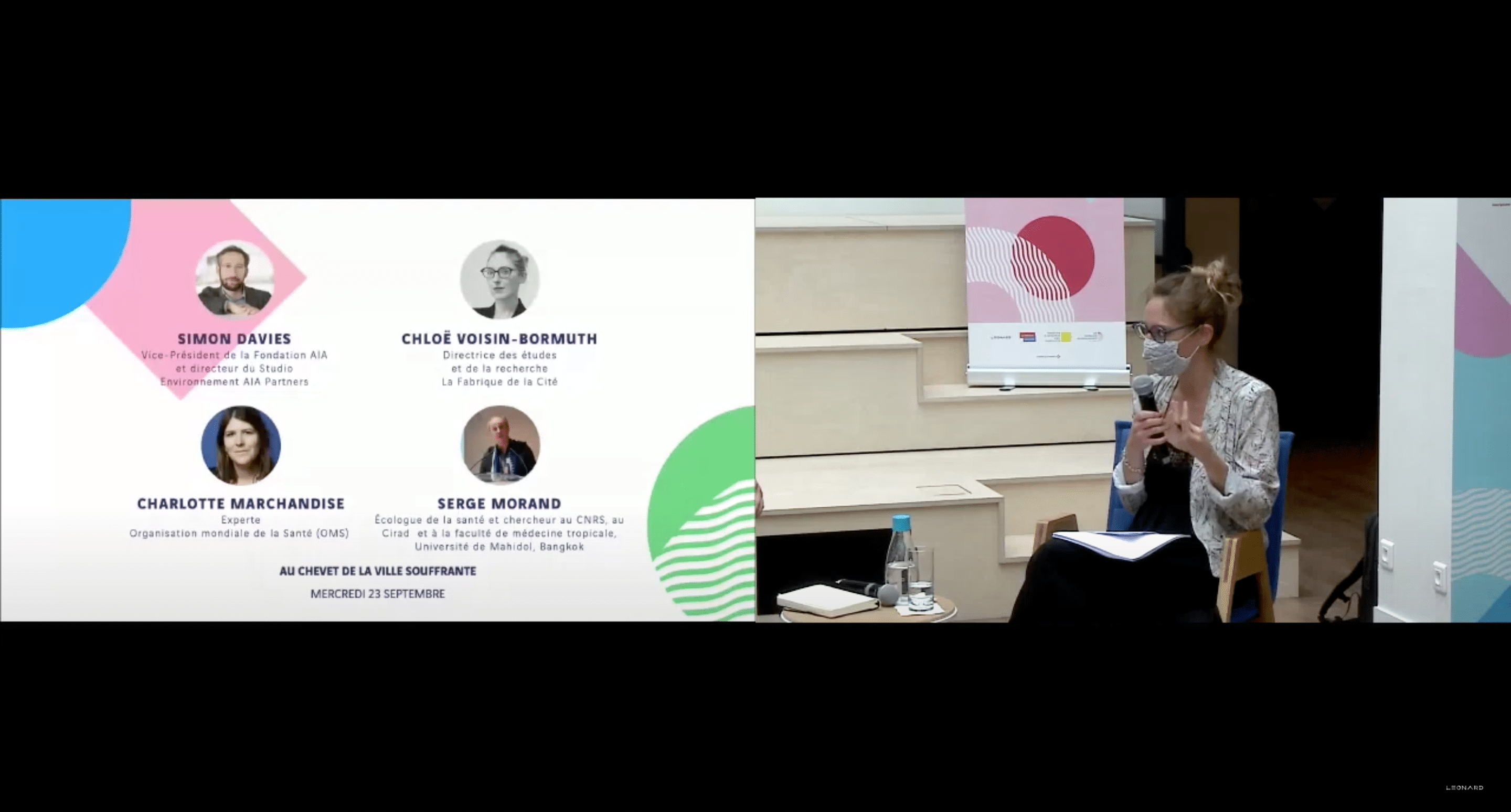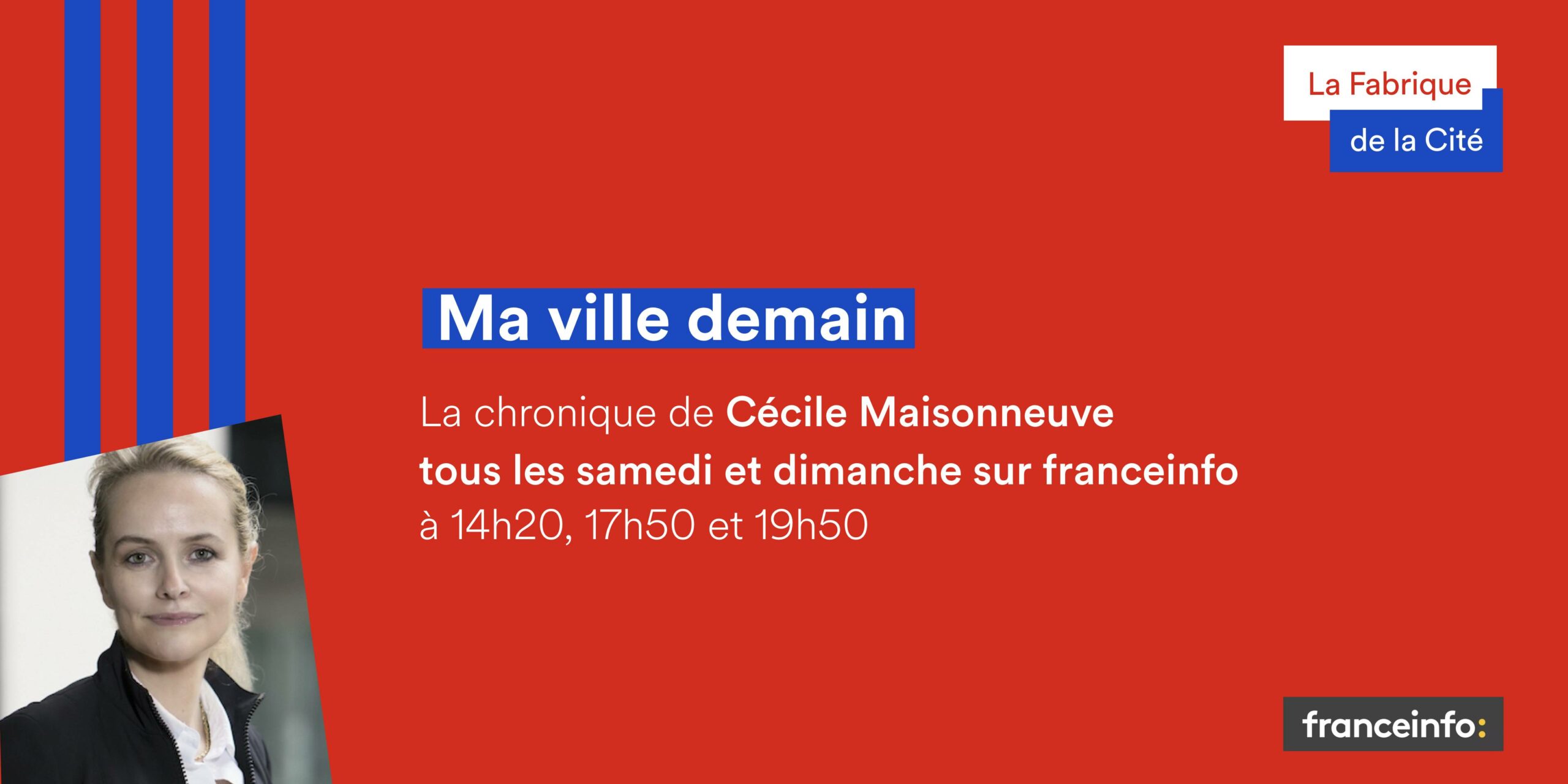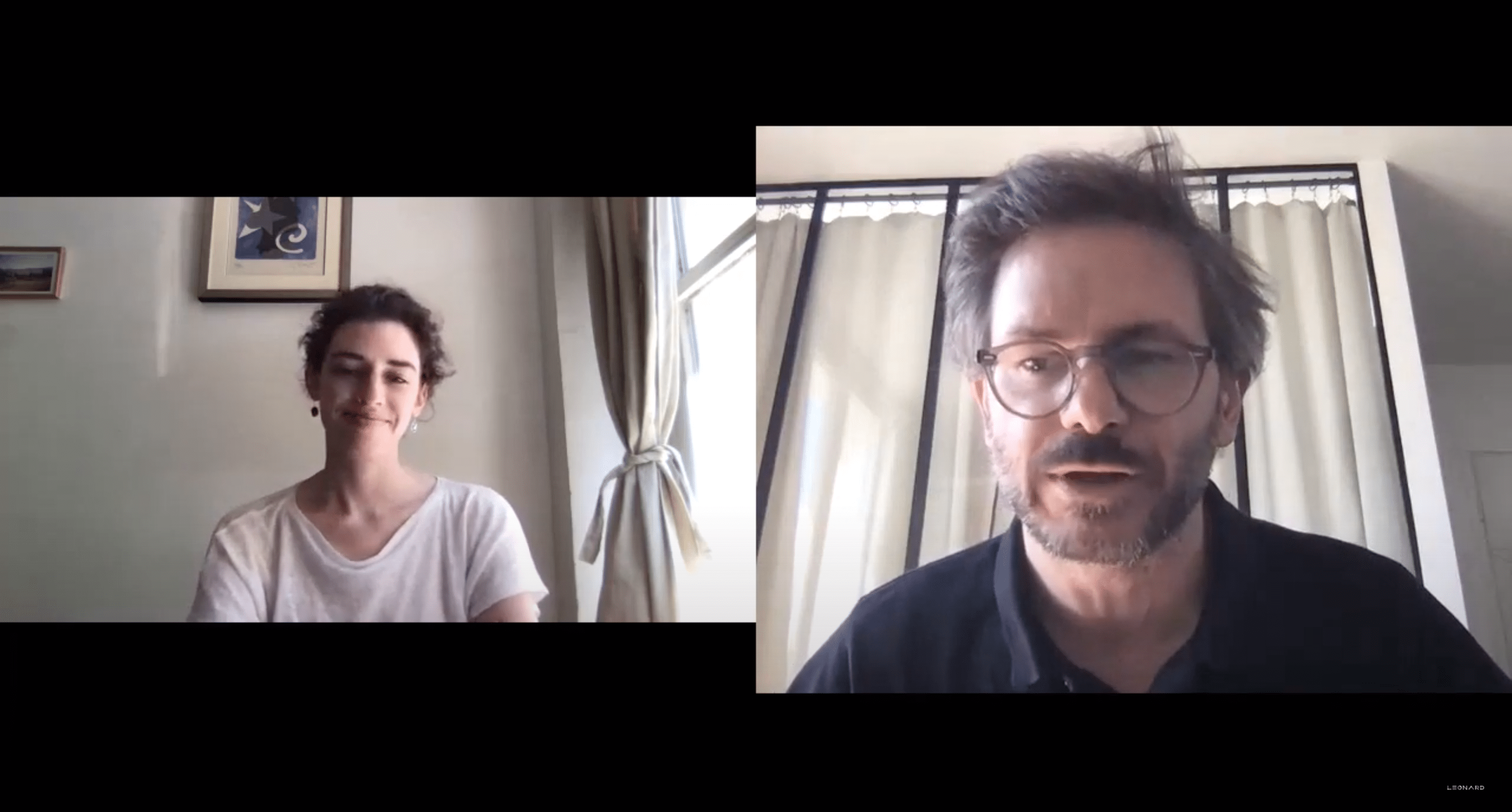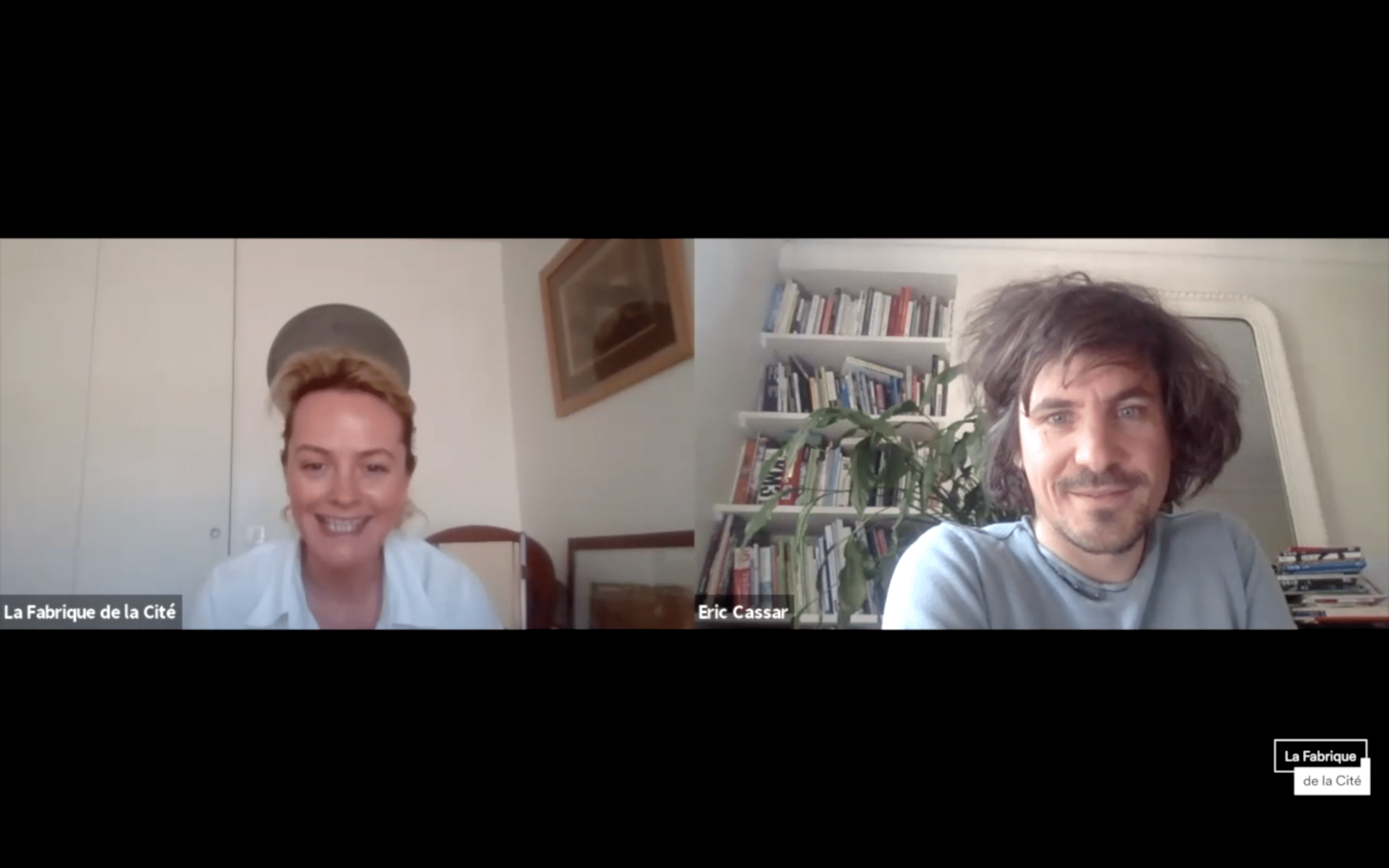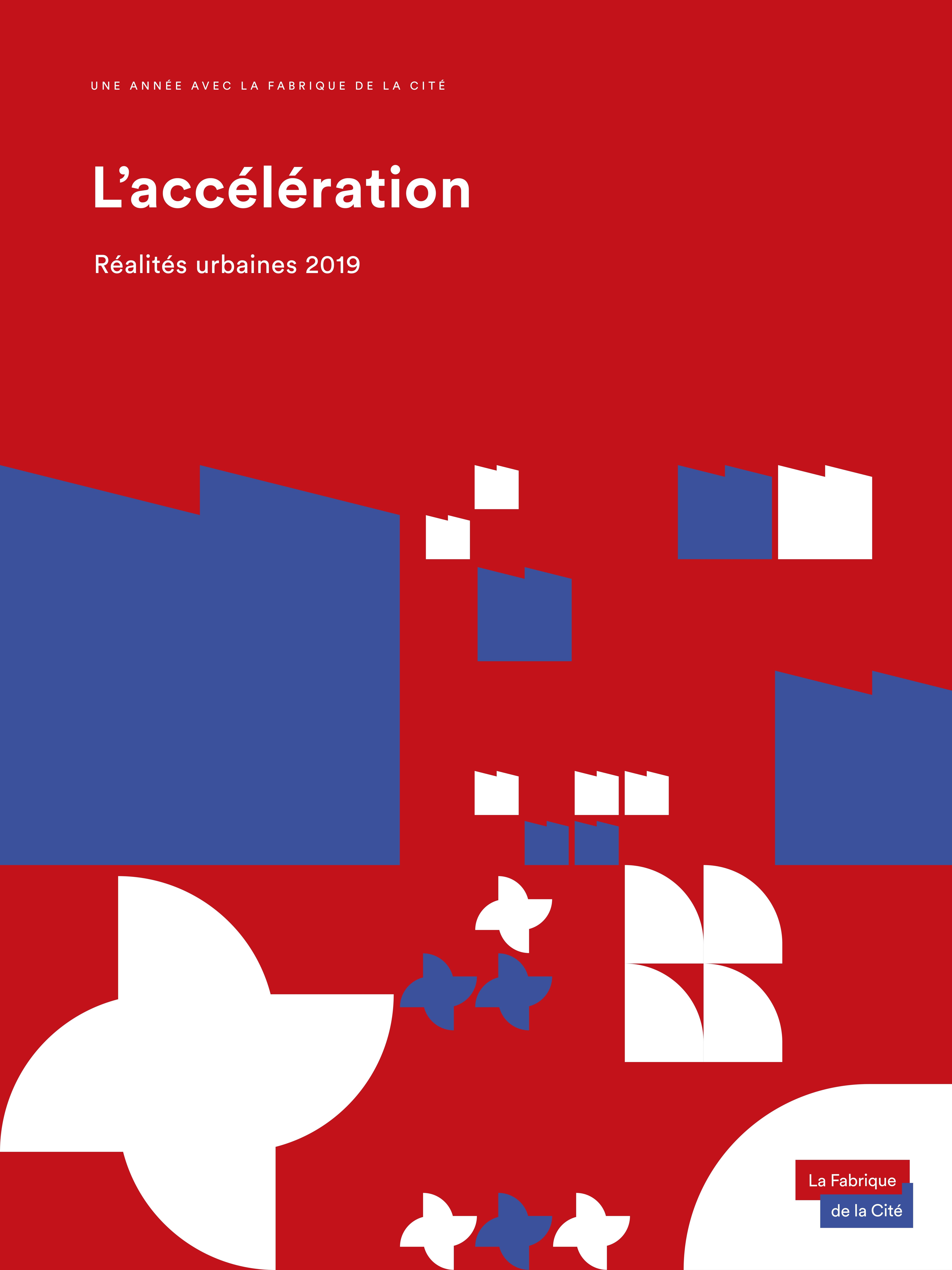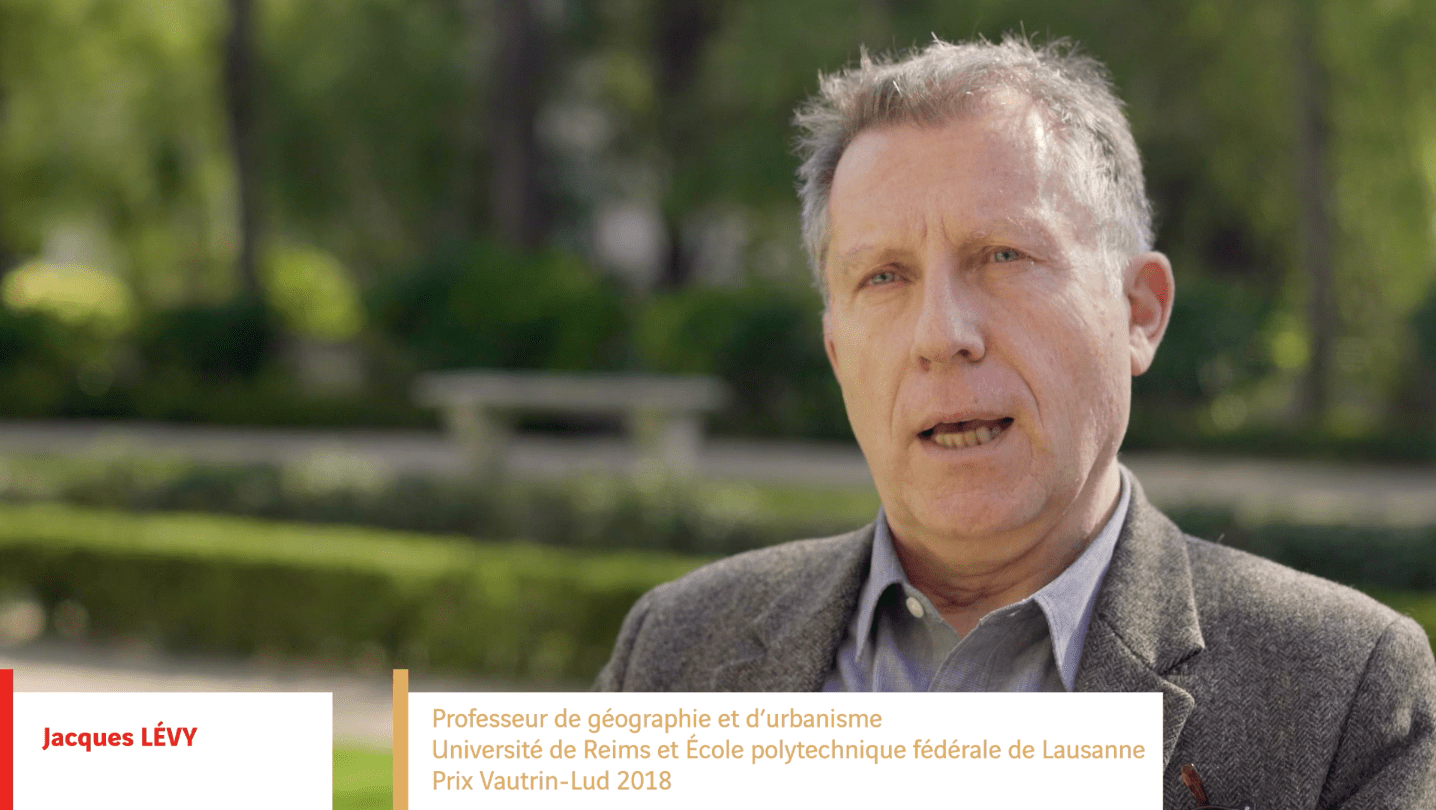Note


Rapport
Villes européennes et réfugiés
Retrouvez cette publication dans le projet :
Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Point de vue d'expert
Sobriété foncière et accès au logement : une nouvelle équation à inventer

Portrait de ville
Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable
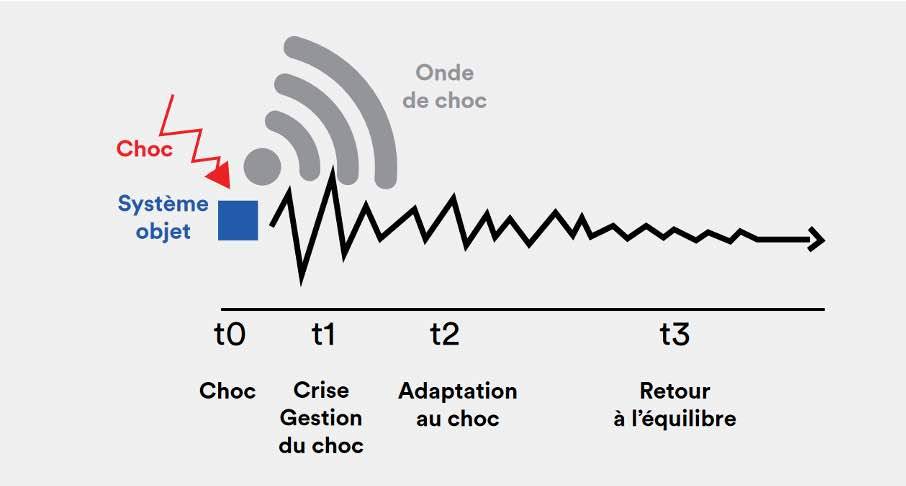
En question
Derrière les mots : la résilience
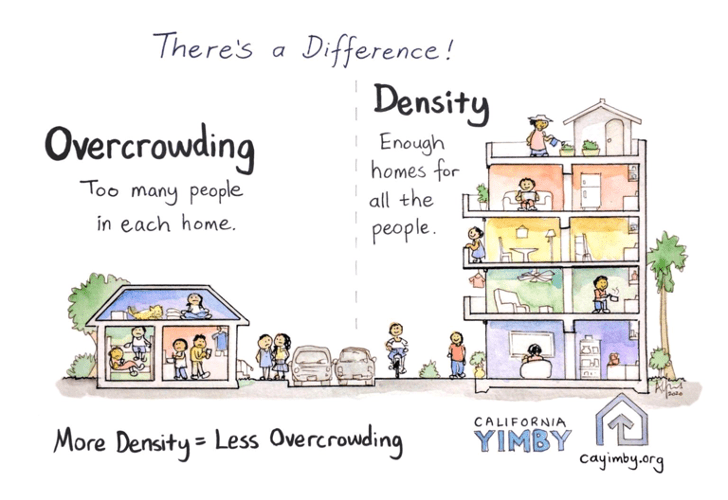
En question
Derrière les mots : la densité

En question
Derrière les mots : le logement abordable
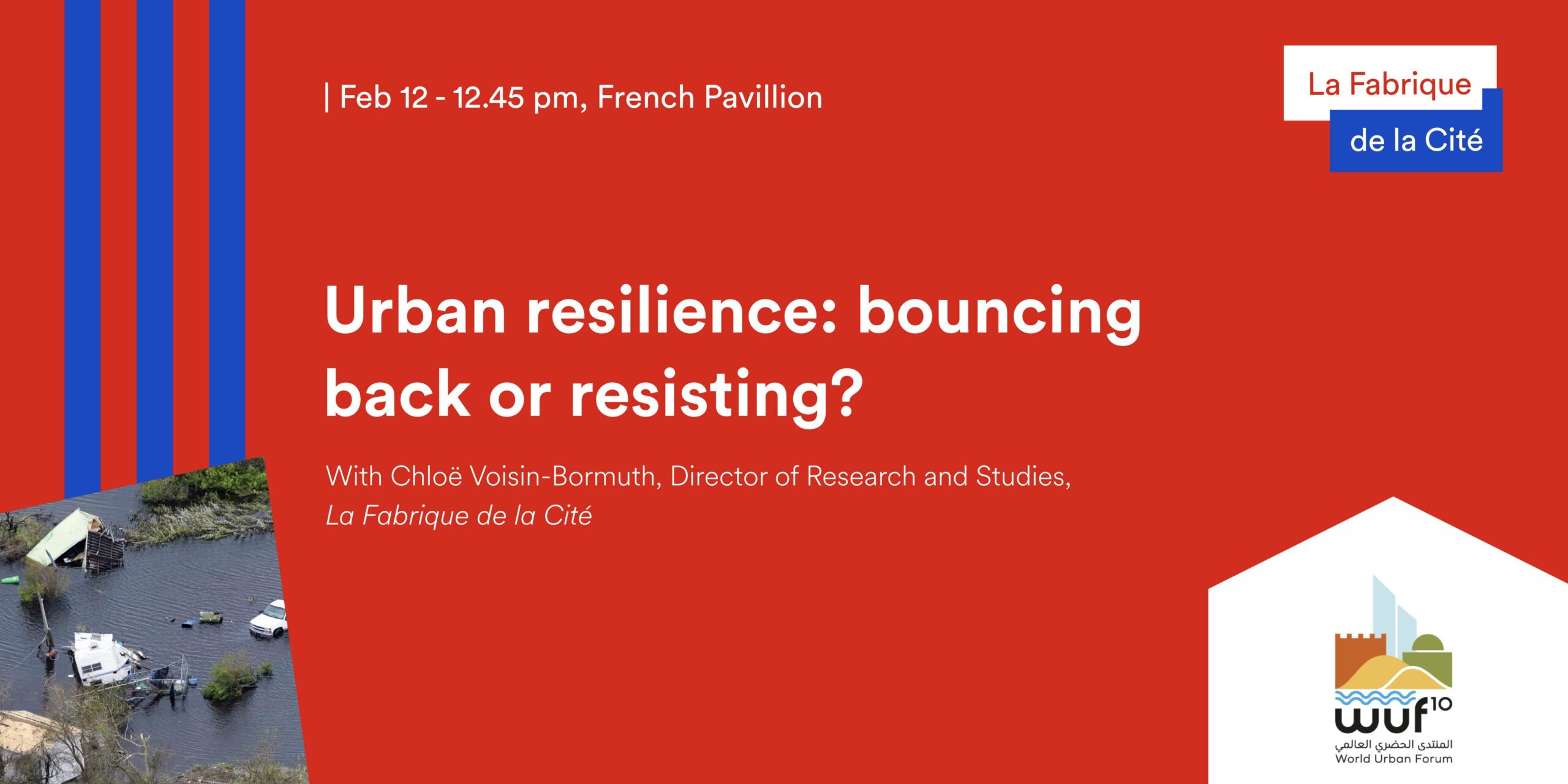
Actualité
Résilience : un concept opérationnel ?

Point de vue d'expert
Les métropoles allemandes face à la crise du logement

Portrait de ville
Pittsburgh : ville industrielle devenue hub d’innovation

Actualité
La résilience, un enjeu pour les villes

Portrait de ville
Hambourg

Rapport
Résilience urbaine
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.