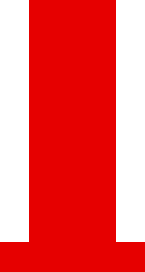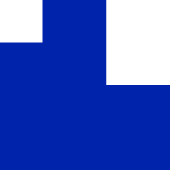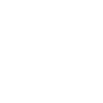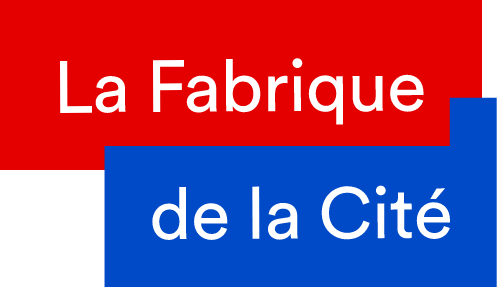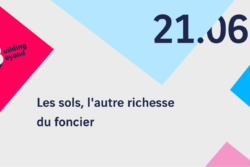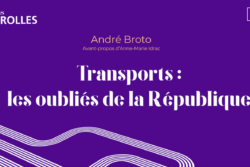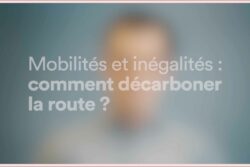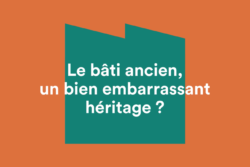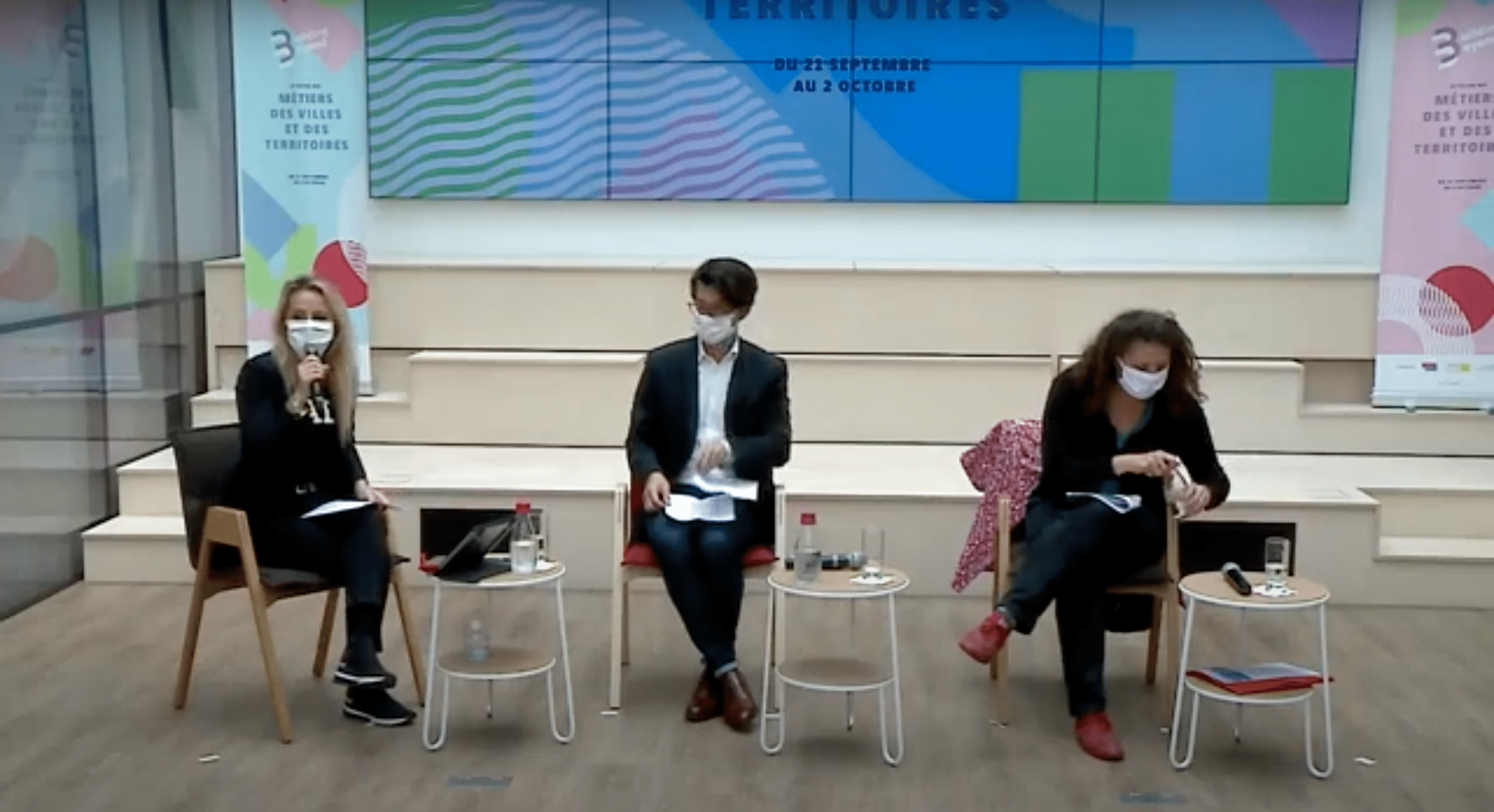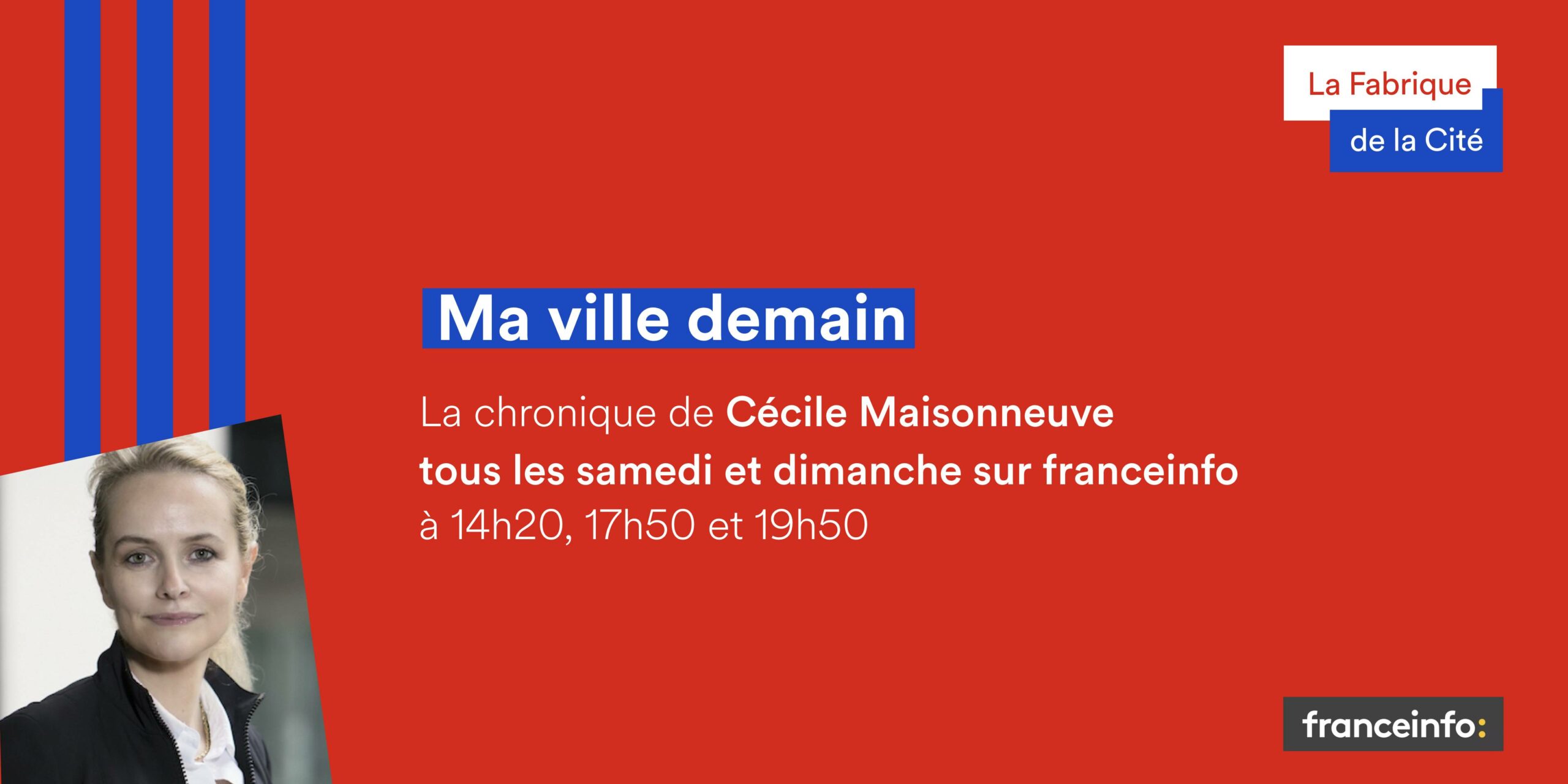Note


Édito
Le rôle des villes après l’accord de Paris
Ces autres publications peuvent aussi vous intéresser :

Portrait de ville
Épinal, pionnier de l’urbanisme circulaire

Point de vue d'expert
Accélérer la transition énergétique : comment territorialiser ?

Portrait de ville
Cahors : innover pour une qualité de vie remarquable
La Fabrique de la Cité
La Fabrique de la Cité est le think tank des transitions urbaines, fondé en 2010 à l’initiative du groupe VINCI, son mécène. Les acteurs de la cité, français et internationaux, y travaillent ensemble à l’élaboration de nouvelles manières de construire et reconstruire les villes.